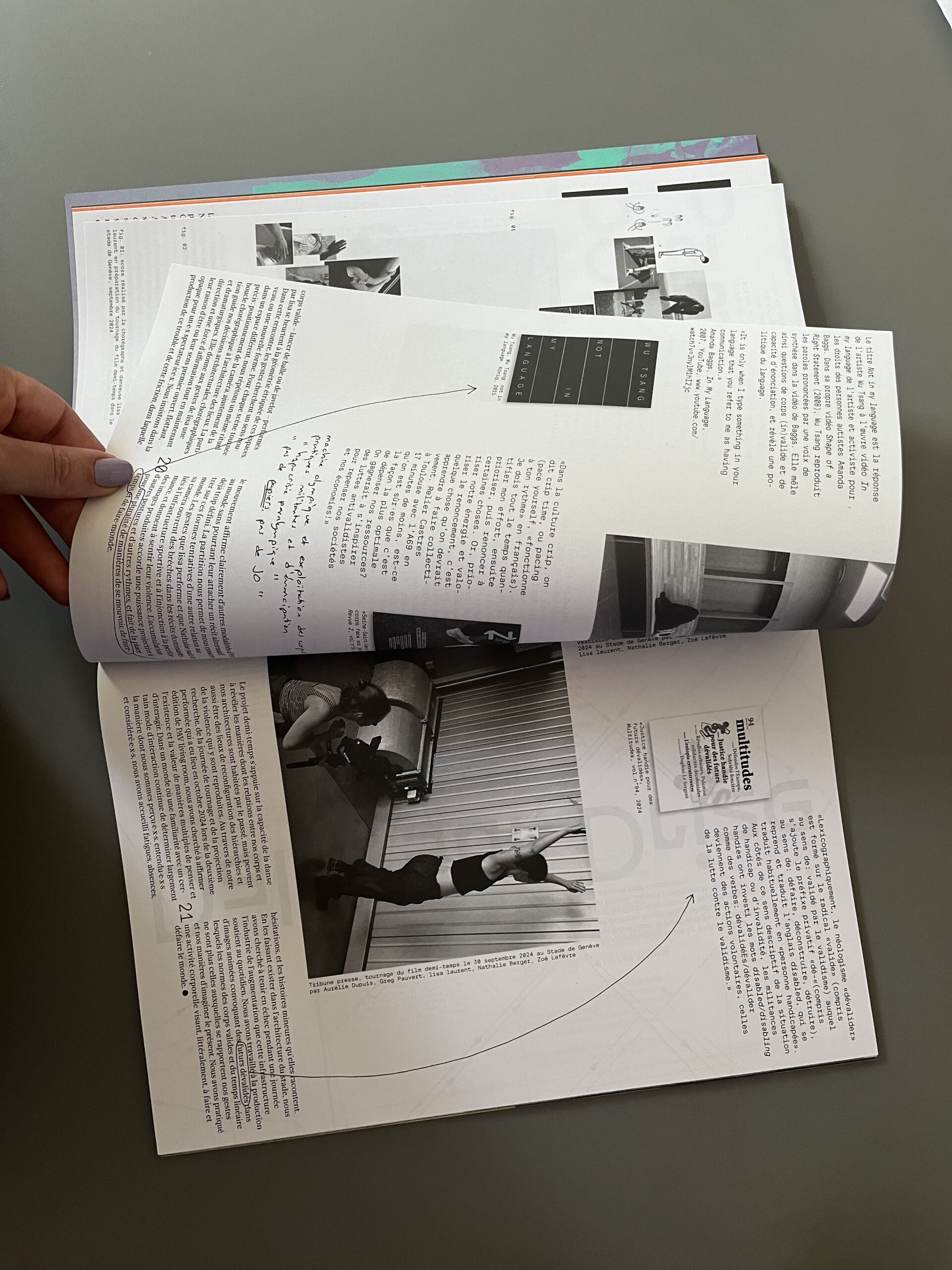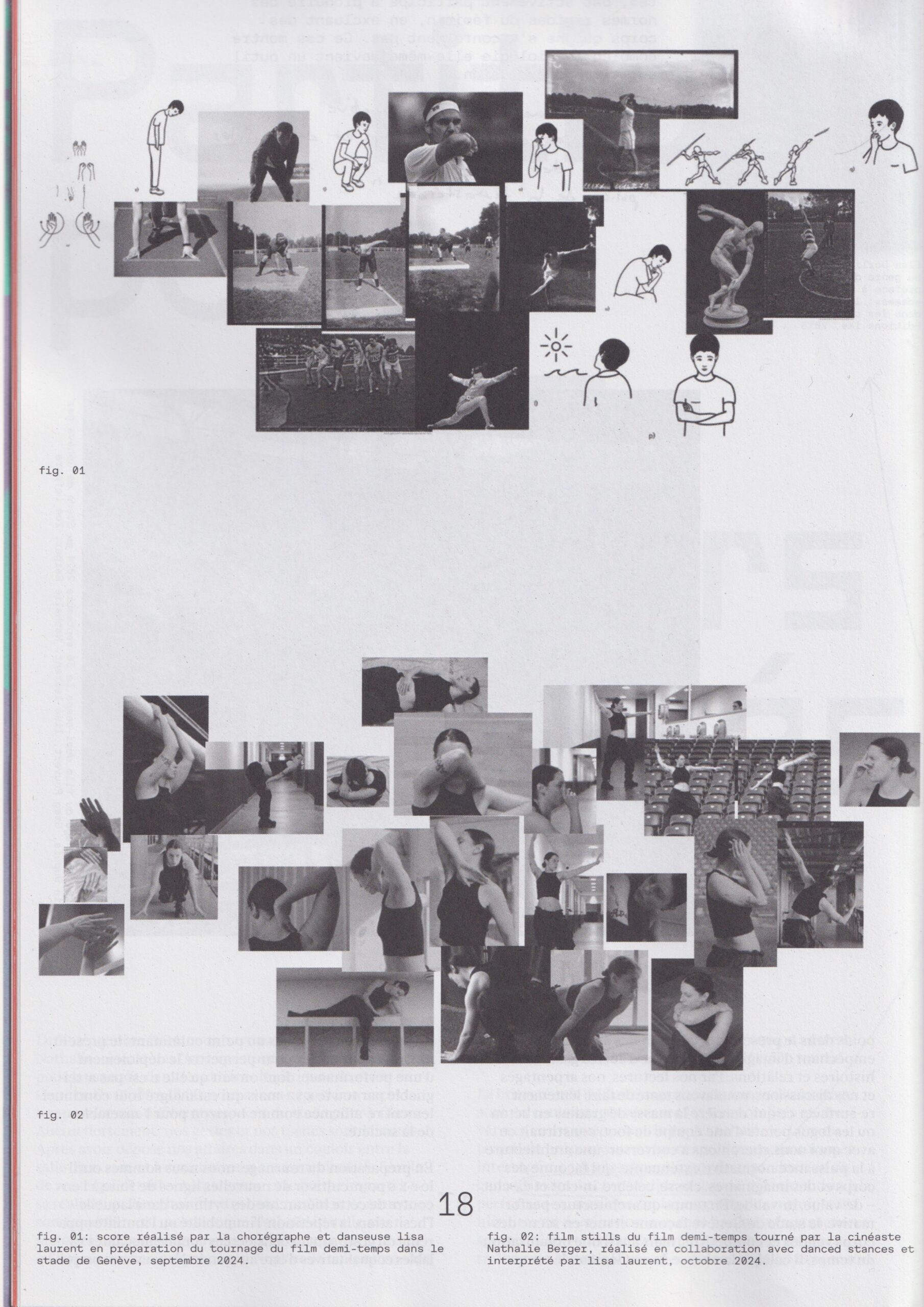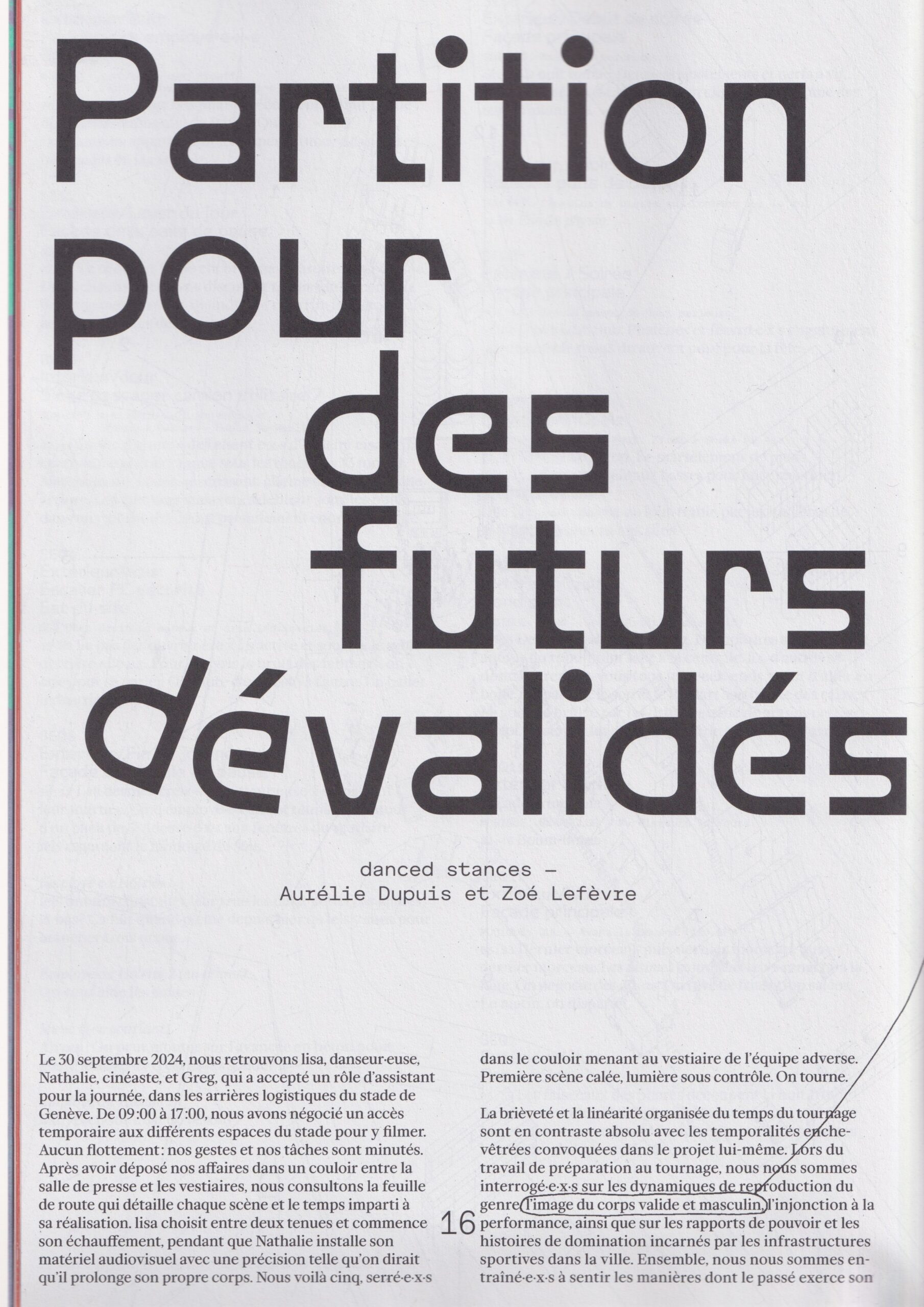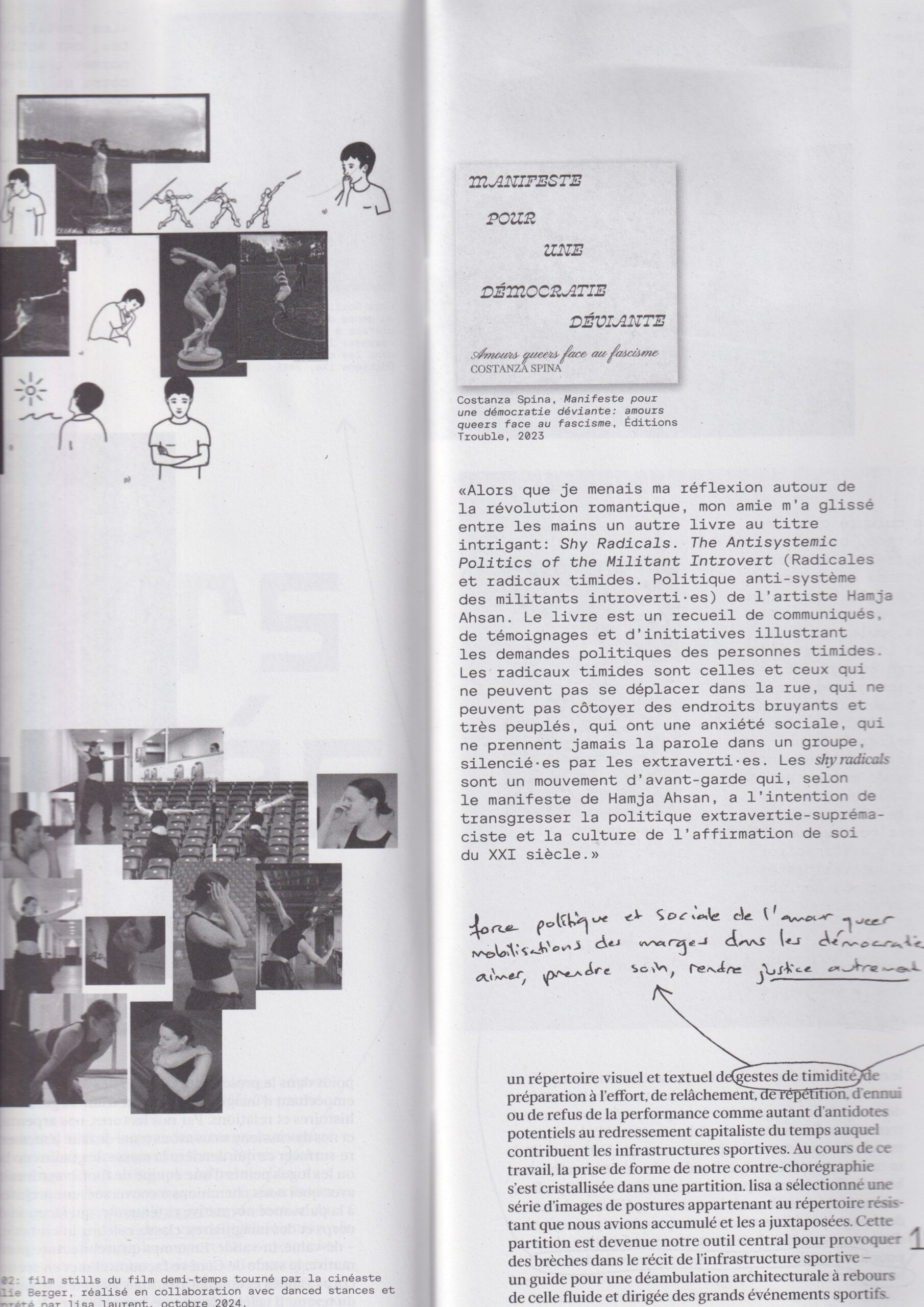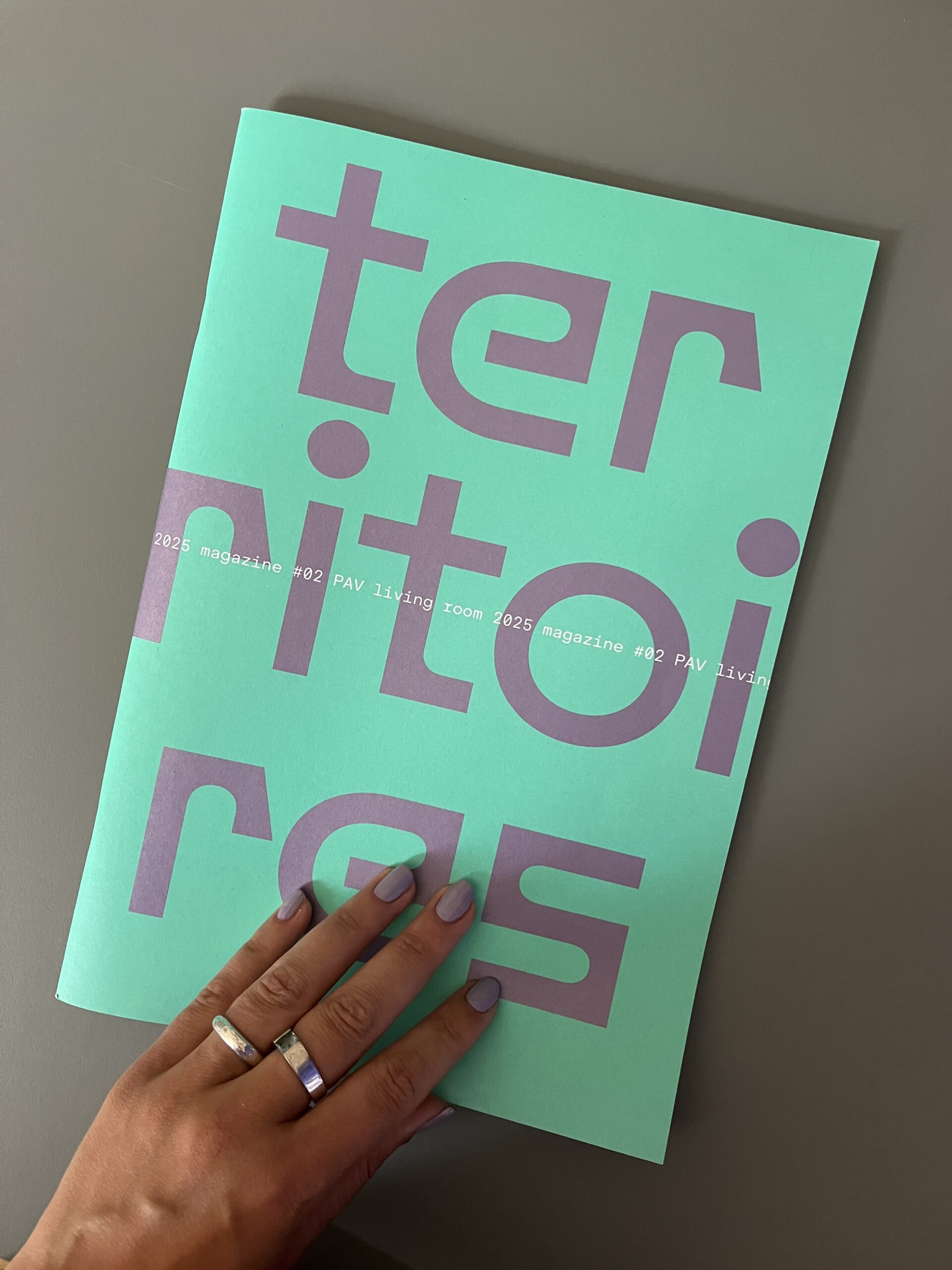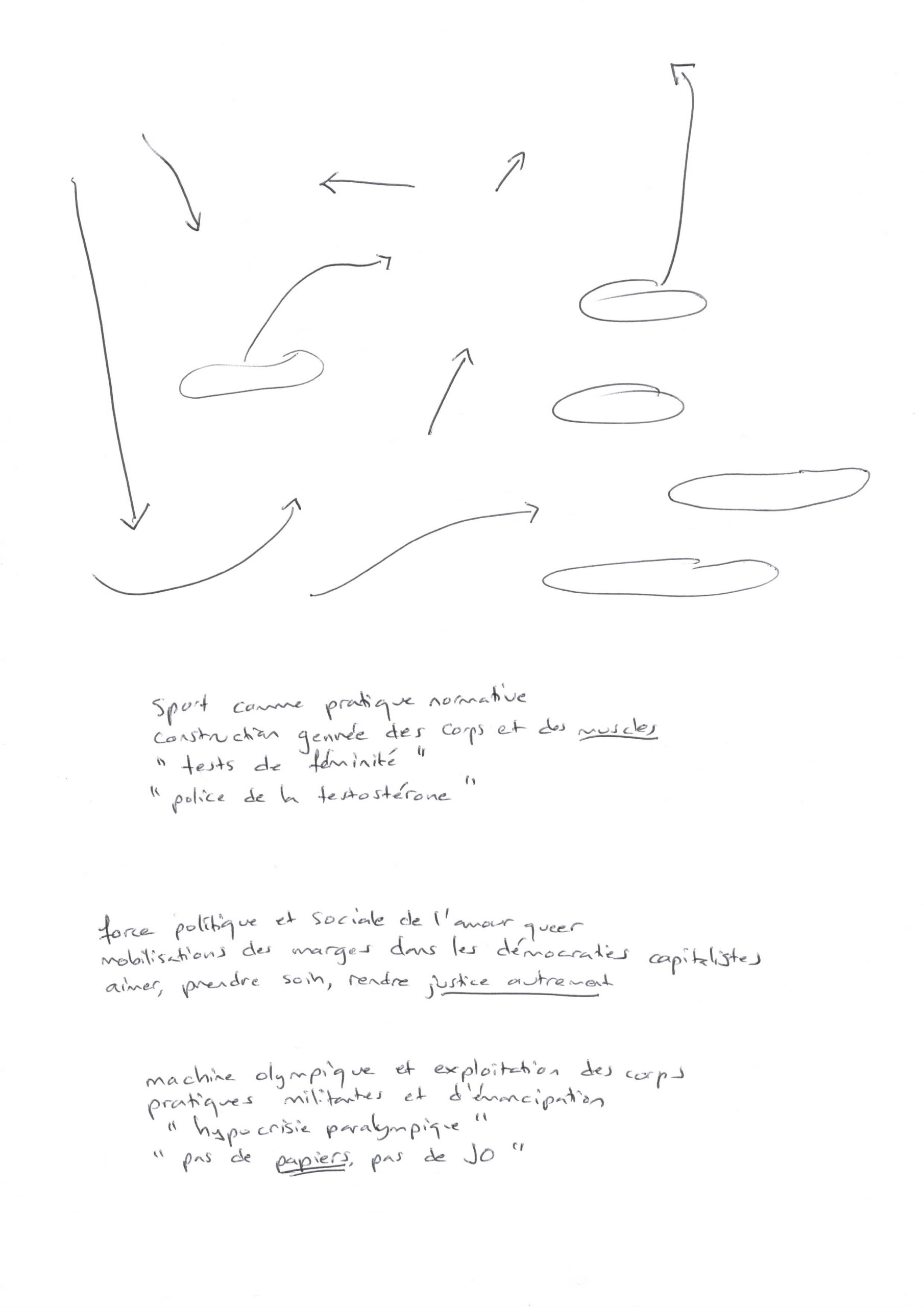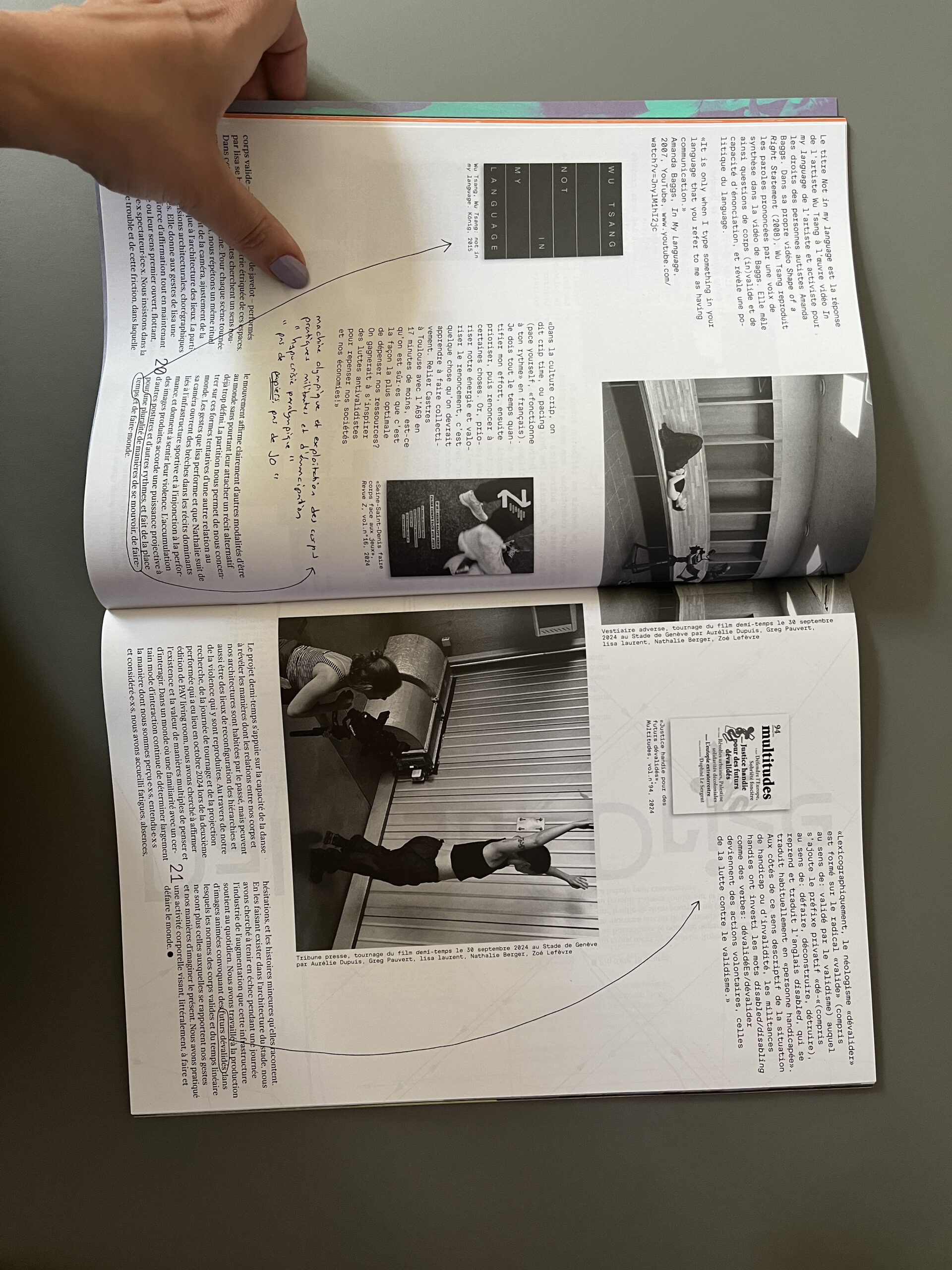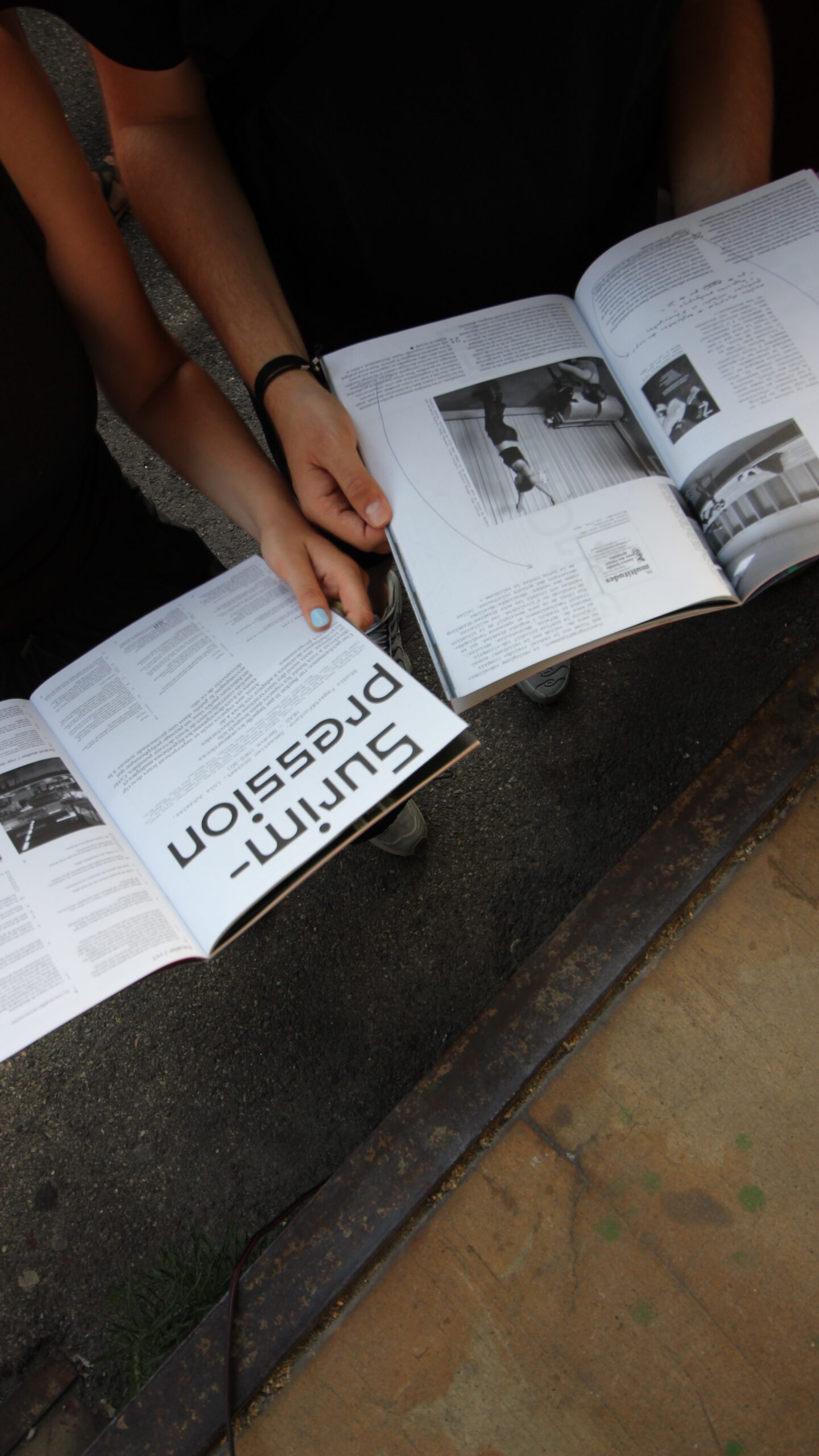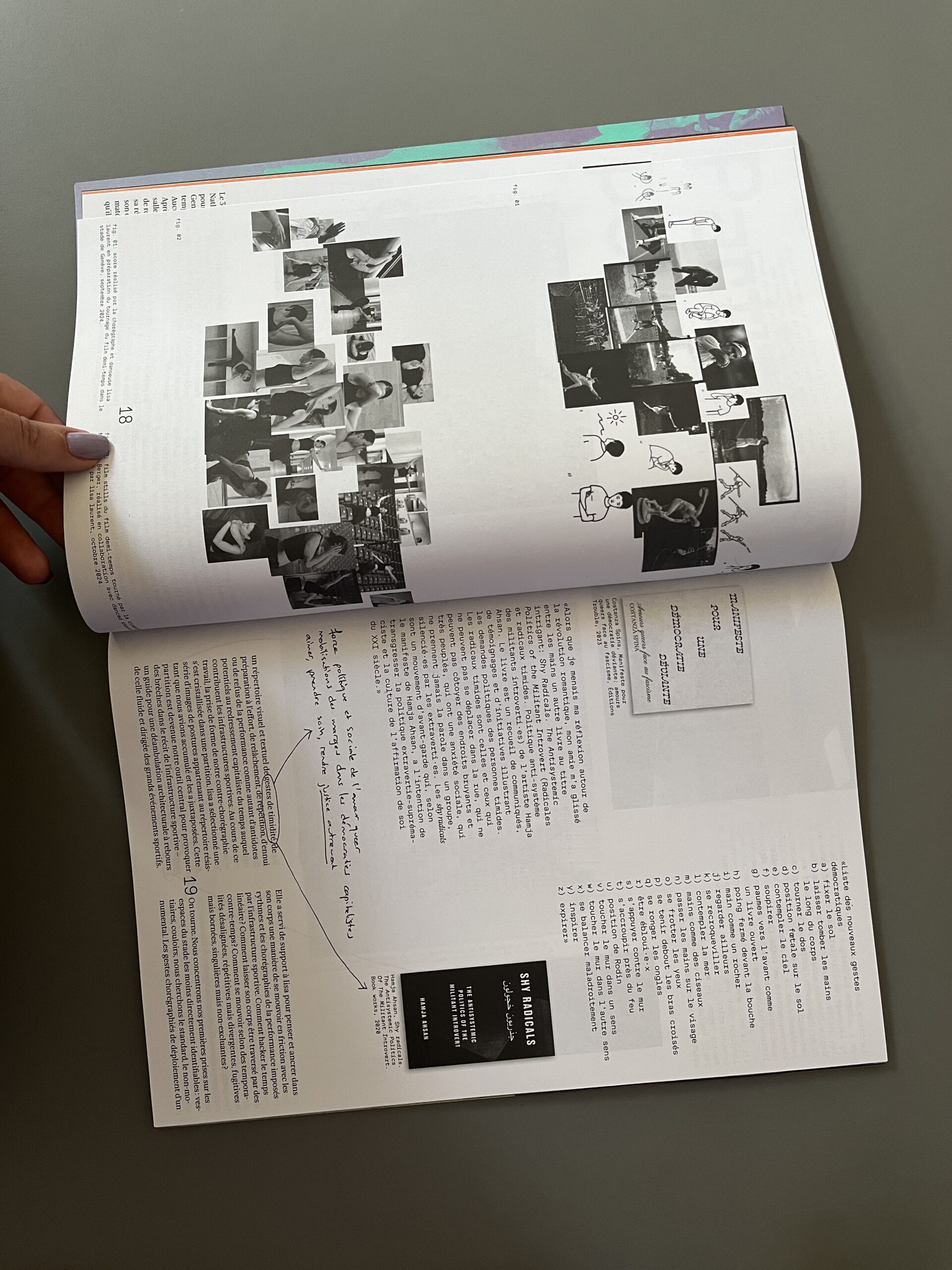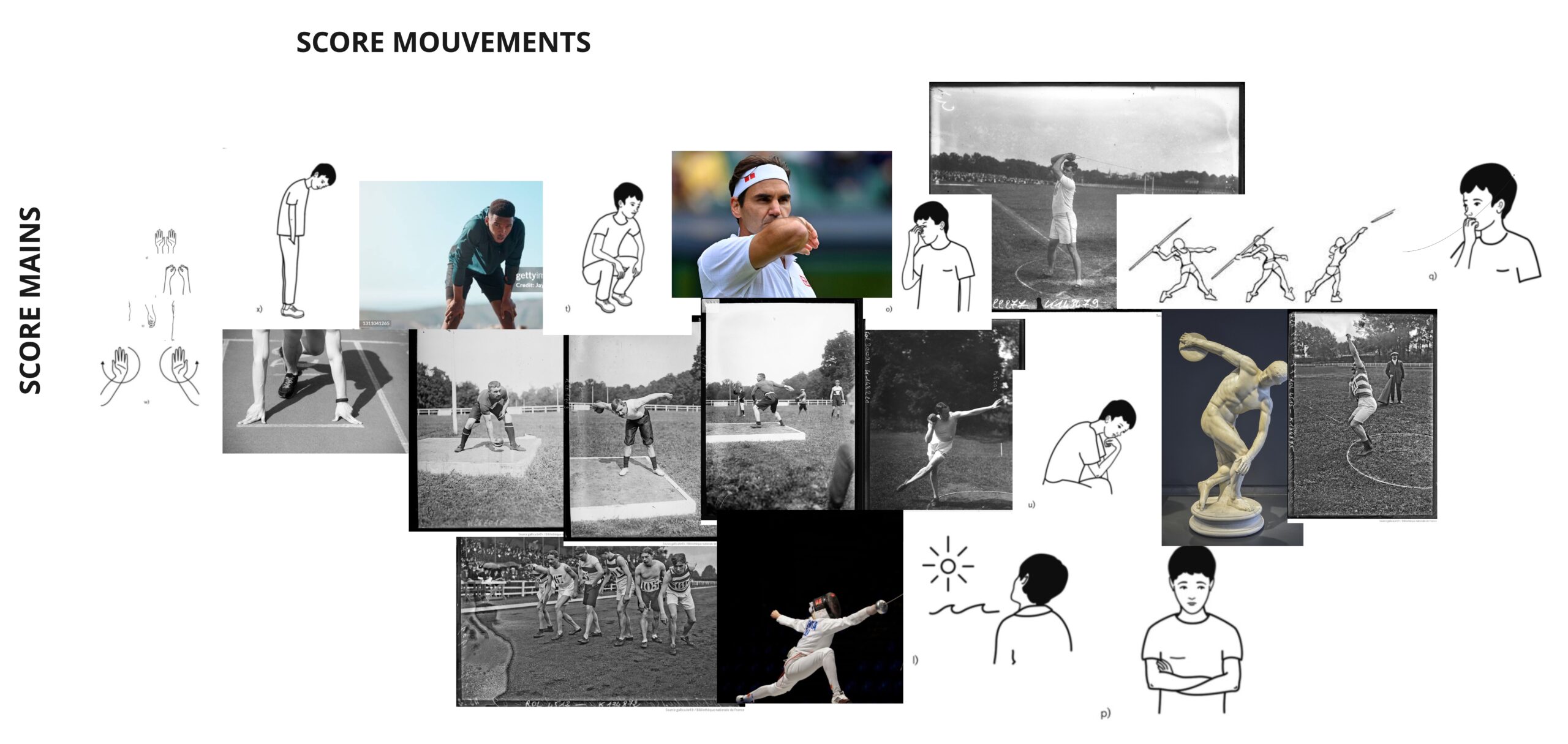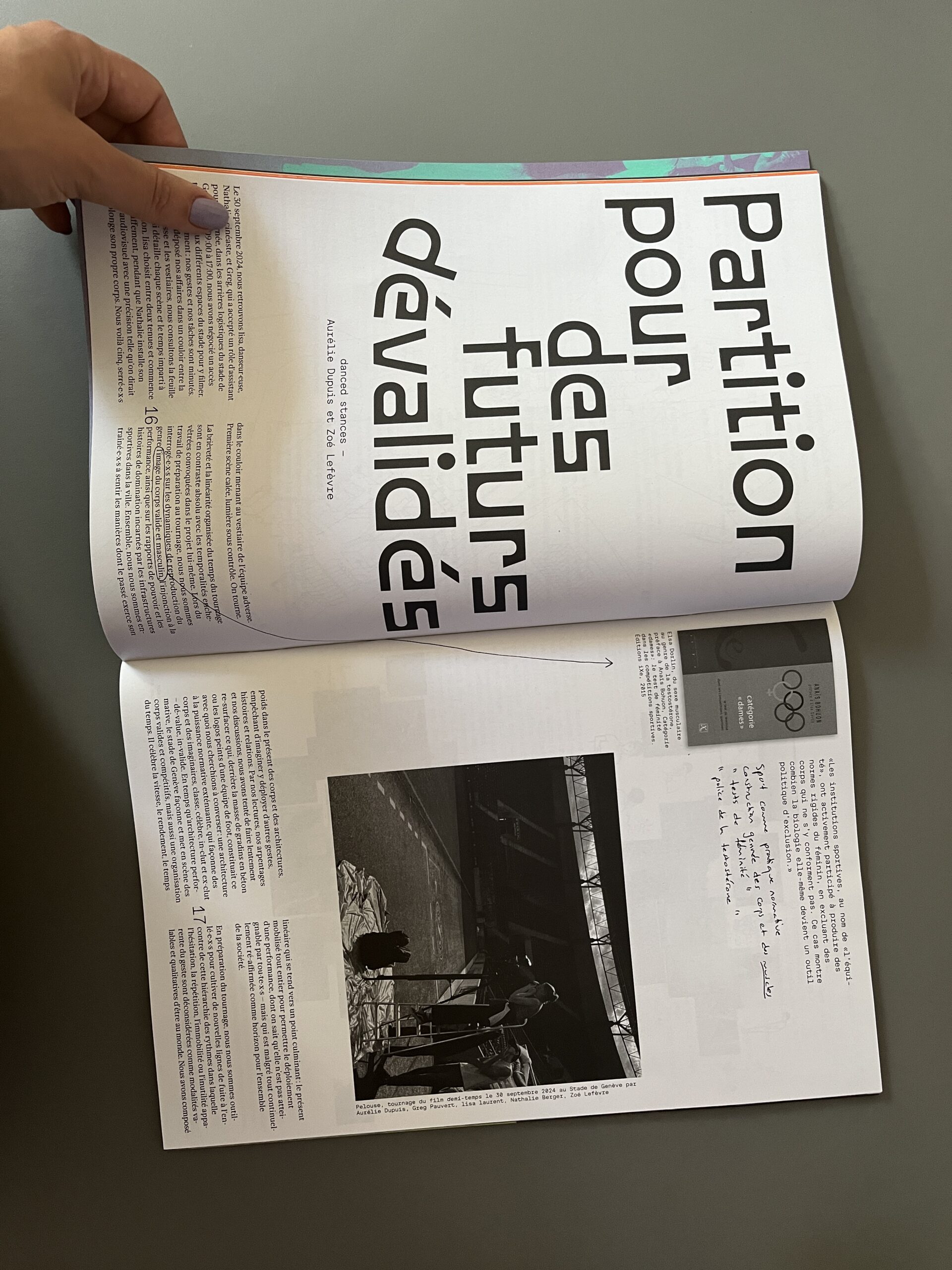déployer
replier
balayer
Publication
Architectural Rehearsal, (Un)Common Precedents in Architectural Design, Routledge, 31.12.2025




Discussion
Let’s not get used to this place, Archizoom EPFL, Lausanne, 28.10.2025










Publication
Partition pour des futurs dévalidés, Magazine PAV living room, Genève, 04.07.2025




Performance
Demi-temps, Marbrerie, Chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge, 13.06.2025


















Texte critique
The wizard is not real, Théâtre de l'Usine, Genève, 08.05.2025
















Texte critique
Arrebentação, Pavillon ADC, Genève, 30.11.2024












Performance
Demi-temps, Entrepôt Balestrafic SA, Rue Baylon 17-19, 1227 Carouge, 25.10.2024


















Performance
La langue du chantier, Pavillon Sicli, Route des Acacias 45, 1227 Genève, 17.10.2024


















Publication
Choréopolice/Choréopolitique, Journal de l'ADC, Genève, 01.10.2024




Publication
Des images qui nous mobilisent, Magazine PAV living room, Genève, 01.07.2024




Performance
Date limite, Marbrerie, Chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge, 31.05.2024




















Performance
Essai de fatigue, Porteous, chemin de la Verseuse 17bis, 1219 Vernier, 25.05.2024